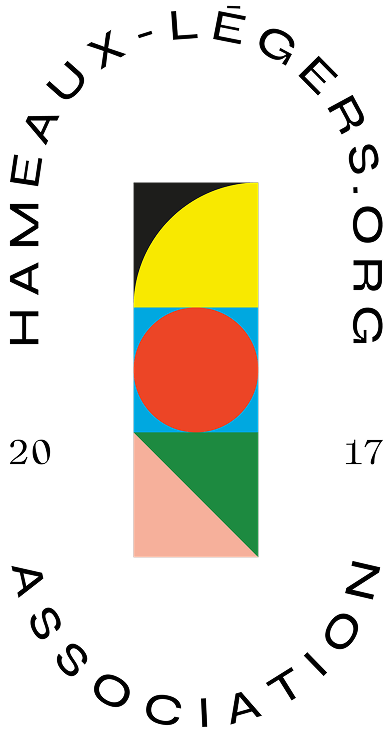INTRODUCTION
Nous allons aborder le cadre réglementaire de l’habitat réversible et du hameau léger. Toujours dans l’objectif de permettre à tous et toutes d’habiter de manière durable et solidaire, l’association Hameaux Légers a exploré les différentes réglementations applicables à une installation en hameau léger. À la fin de cette action, vous aurez une vue d’ensemble des éléments à considérer pour faciliter son intégration réglementairement.
Déroulé de l'action

Le cadre de loi pour l’habitat réversible
Le cadre réglementaire relatif à l'habitat réversible, aussi appelé habitat léger, est récent et souvent méconnu des citoyen·nes, des élu·es et des administrations. Nous avons à cœur de clarifier cette réglementation pour tous et toutes pour ainsi permettre l’installation en habitat réversible et en hameau léger grâce à l’application de la loi ALUR de 2014.
Pour commencer, il est important de rappeler que la loi ALUR impose de prendre en compte l’ensemble des modes d’habiter dans les documents d’urbanisme comme le mentionne l’article L121-1 paragraphe 2 du Code de l’Urbanisme : « Les [...] plans locaux d'urbanisme [...] déterminent les conditions permettant d'assurer [...] : [...] La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat [...] ».
Le cadre de loi pour l’habitat réversible
Le cadre réglementaire relatif à l'habitat réversible, aussi appelé habitat léger, est récent et souvent méconnu des citoyen·nes, des élu·es et des administrations. Nous avons à cœur de clarifier cette réglementation pour tous et toutes pour ainsi permettre l’installation en habitat réversible et en hameau léger grâce à l’application de la loi ALUR de 2014.
Pour commencer, il est important de rappeler que la loi ALUR impose de prendre en compte l’ensemble des modes d’habiter dans les documents d’urbanisme comme le mentionne l’article L121-1 paragraphe 2 du Code de l’Urbanisme : « Les [...] plans locaux d'urbanisme [...] déterminent les conditions permettant d'assurer [...] : [...] La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat [...] ».

Une typologie d’habitat, différents usages
L’habitat réversible est une typologie d’habitat mais son usage peut être différent pour chaque installation. En effet, une installation peut être envisagée sur une durée temporaire avec les habitats légers de loisirs, par exemple pour un camping, ou à l’année pour des habitant·es qui choisissent simplement une alternative à la maison classique.
L’usage déterminera alors la catégorie juridique applicable pour l’installation envisagée.
Il existe une diversité de catégories juridiques liées à l’habitat réversible :
- Un usage de loisirs, une installation moins de 8 mois par an :
- Les habitats légers de loisirs - HLL ;
- La résidence mobile de loisirs (RML ou mobil-home) ;
- Les caravanes.
- Un usage à l’année en s’installant a minima 8 mois par an :
- Les “résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs” ;
- Les résidences mobiles des gens du voyage ;
- L’habitat flottant.
Une typologie d’habitat, différents usages
L’habitat réversible est une typologie d’habitat mais son usage peut être différent pour chaque installation. En effet, une installation peut être envisagée sur une durée temporaire avec les habitats légers de loisirs, par exemple pour un camping, ou à l’année pour des habitant·es qui choisissent simplement une alternative à la maison classique.
L’usage déterminera alors la catégorie juridique applicable pour l’installation envisagée.
Il existe une diversité de catégories juridiques liées à l’habitat réversible :
- Un usage de loisirs, une installation moins de 8 mois par an :
- Les habitats légers de loisirs - HLL ;
- La résidence mobile de loisirs (RML ou mobil-home) ;
- Les caravanes.
- Un usage à l’année en s’installant a minima 8 mois par an :
- Les “résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs” ;
- Les résidences mobiles des gens du voyage ;
- L’habitat flottant.

Zoom sur les “résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs”
La loi ALUR permet, depuis 2014, la prise en compte de l’habitat réversible comme résidence à l’année en intégrant cette notion de “résidence démontable constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs” (art. R111-51 du Code de l’Urbanisme).
3 critères sont mentionnés :
- « Occupées au moins 8 mois par an »
- « Sans fondations »
- « Facilement et rapidement démontable »
La loi précise par ailleurs que cette installation peut être autonome vis-à-vis des réseaux publics d’eau, d’électricité, et d’assainissement. Si le choix est fait de ne pas raccorder les habitats aux réseaux publics, une attestation permettant de s’assurer du respect des règles d’hygiène et de sécurité devra être ajoutée au dossier d’autorisation d’urbanisme en précisant les conditions dans lesquelles sont satisfaits les besoins des occupant·es en eau, assainissement et électricité . Dans les zones naturelles, agricoles et forestières, ces conditions seront fixées, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme (Article R*441-6-1 du Code de l’urbanisme).
Pour considérer une installation en habitat réversible à l’année pour un projet de hameau léger, cette catégorie juridique s’applique.
Les autres catégories juridiques
Si les“résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs” représentent l’option la plus sécurisante pour y vivre de manière permanente, il existe d’autres catégories correspondant à d’autres types d’installation en habitat réversible, pour lesquelles la réglementation est différente.
Voici un tableau récapitulatif des différents statuts existants : Cadre légal de l'habitat réversible.
Le cas particulier de la tiny house
Aucune définition spécifique n’est précisée pour la « tiny house » dans le code de l'urbanisme. Dans le cadre d’une question écrite sur le sujet « Qualification juridique des résidences démontables sur roues constituant l'habitat permanent », une réponse sénatoriale a été donné pour apporter un peu de clarté sur les différentes applications si cet habitat garde ou non son moyen de mobilité (roues).
« […] Dans le cas où ces habitats ne disposeraient pas en permanence de moyens de mobilité propres, ils peuvent être assimilés au régime juridique actuel des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs (par exemple, yourtes ou tipis) prévues à l'article R. 111-51 du code de l'urbanisme. S'agissant de « tiny houses » conservant en permanence un moyen de mobilité et destinées à un usage de loisirs, elles peuvent être assimilées soit à des caravanes soit à des résidences mobiles de loisirs (RML). […] »
Question écrite n°08720 - 15e législature
Le cadre réglementaire en fonction de votre zone d’installation
Si la commune de votre projet d’installation en habitat réversible ou en hameau léger est couverte par un Plan Local d’Urbanisme (Intercommunal), l’installation en habitat réversible en tant que “résidence démontable constituant l’habitat permanent de leur utilisateur” sera possible en fonction de votre zone d’installation :
En zone constructible d’un PLU(i) :
- Zone U ou AU : les résidences démontables sont autorisées sous réserve du respect du règlement
- Zone 2AU : les résidences démontables ne sont pas autorisées sauf modification ou révision du PLU(i)
En zone non constructible d’un PLU(i), c’est-à-dire en zone naturelle N ou agricole A :
- Les résidences démontables ne sont pas autorisées sauf dans le cadre :
- d’un STECAL (Secteur de Taille Et de Capacité d'Accueil Limitée) autorisant les résidences démontables (article L444-1 ci-dessus, article L. 151-13, CU) ;
- d’un permis précaire, pouvant par définition s’inscrire hors du cadre réglementaire ;
- d’un habitat agricole ;
- d’une autorisation de stationner (résidences mobiles).
Si la commune de votre projet d’installation en habitat réversible ou en hameau léger n'est pas couverte par un Plan Local d’Urbanisme, elle est alors sous carte communale ou sous le régime du règlement national d'urbanisme (RNU).
Plusieurs cas s’appliquent alors :
- En zone constructible d'une carte communale, les résidences démontables sont autorisées et aucune autre dérogation n’est prévue.
- En l'absence de document d'urbanisme, les résidences démontables sont autorisées sous réserve de respect du :
- RNU (Règlement National d'Urbanisme) ;
- Et du principe de constructibilité limitée avec une installation sur des zones déjà urbanisées et une dérogation sur délibération motivée du conseil municipal et un avis conforme de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).
Zoom sur les “résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs”
La loi ALUR permet, depuis 2014, la prise en compte de l’habitat réversible comme résidence à l’année en intégrant cette notion de “résidence démontable constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs” (art. R111-51 du Code de l’Urbanisme).
3 critères sont mentionnés :
- « Occupées au moins 8 mois par an »
- « Sans fondations »
- « Facilement et rapidement démontable »
La loi précise par ailleurs que cette installation peut être autonome vis-à-vis des réseaux publics d’eau, d’électricité, et d’assainissement. Si le choix est fait de ne pas raccorder les habitats aux réseaux publics, une attestation permettant de s’assurer du respect des règles d’hygiène et de sécurité devra être ajoutée au dossier d’autorisation d’urbanisme en précisant les conditions dans lesquelles sont satisfaits les besoins des occupant·es en eau, assainissement et électricité . Dans les zones naturelles, agricoles et forestières, ces conditions seront fixées, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme (Article R*441-6-1 du Code de l’urbanisme).
Pour considérer une installation en habitat réversible à l’année pour un projet de hameau léger, cette catégorie juridique s’applique.
Les autres catégories juridiques
Si les“résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs” représentent l’option la plus sécurisante pour y vivre de manière permanente, il existe d’autres catégories correspondant à d’autres types d’installation en habitat réversible, pour lesquelles la réglementation est différente.
Voici un tableau récapitulatif des différents statuts existants : Cadre légal de l'habitat réversible.
Le cas particulier de la tiny house
Aucune définition spécifique n’est précisée pour la « tiny house » dans le code de l'urbanisme. Dans le cadre d’une question écrite sur le sujet « Qualification juridique des résidences démontables sur roues constituant l'habitat permanent », une réponse sénatoriale a été donné pour apporter un peu de clarté sur les différentes applications si cet habitat garde ou non son moyen de mobilité (roues).
« […] Dans le cas où ces habitats ne disposeraient pas en permanence de moyens de mobilité propres, ils peuvent être assimilés au régime juridique actuel des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs (par exemple, yourtes ou tipis) prévues à l'article R. 111-51 du code de l'urbanisme. S'agissant de « tiny houses » conservant en permanence un moyen de mobilité et destinées à un usage de loisirs, elles peuvent être assimilées soit à des caravanes soit à des résidences mobiles de loisirs (RML). […] »
Question écrite n°08720 - 15e législature
Le cadre réglementaire en fonction de votre zone d’installation
Si la commune de votre projet d’installation en habitat réversible ou en hameau léger est couverte par un Plan Local d’Urbanisme (Intercommunal), l’installation en habitat réversible en tant que “résidence démontable constituant l’habitat permanent de leur utilisateur” sera possible en fonction de votre zone d’installation :
En zone constructible d’un PLU(i) :
- Zone U ou AU : les résidences démontables sont autorisées sous réserve du respect du règlement
- Zone 2AU : les résidences démontables ne sont pas autorisées sauf modification ou révision du PLU(i)
En zone non constructible d’un PLU(i), c’est-à-dire en zone naturelle N ou agricole A :
- Les résidences démontables ne sont pas autorisées sauf dans le cadre :
- d’un STECAL (Secteur de Taille Et de Capacité d'Accueil Limitée) autorisant les résidences démontables (article L444-1 ci-dessus, article L. 151-13, CU) ;
- d’un permis précaire, pouvant par définition s’inscrire hors du cadre réglementaire ;
- d’un habitat agricole ;
- d’une autorisation de stationner (résidences mobiles).
Si la commune de votre projet d’installation en habitat réversible ou en hameau léger n'est pas couverte par un Plan Local d’Urbanisme, elle est alors sous carte communale ou sous le régime du règlement national d'urbanisme (RNU).
Plusieurs cas s’appliquent alors :
- En zone constructible d'une carte communale, les résidences démontables sont autorisées et aucune autre dérogation n’est prévue.
- En l'absence de document d'urbanisme, les résidences démontables sont autorisées sous réserve de respect du :
- RNU (Règlement National d'Urbanisme) ;
- Et du principe de constructibilité limitée avec une installation sur des zones déjà urbanisées et une dérogation sur délibération motivée du conseil municipal et un avis conforme de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).

Les démarches d’autorisation d’urbanisme
Pour toute installation ou construction d’un habitat, une démarche d’autorisation d’urbanisme doit être déposée auprès des services instructeurs de votre commune. L'instruction des permis et des autres actes est faite par les services de la commune ou de l'EPCI compétent (Établissement public de coopération intercommunale) comme, par exemple, la communauté de communes.Les autorisations d’urbanisme à solliciter pour l’installation d’une résidence démontable constituant l’habitat permanent de ses utilisateurs varient en fonction du nombre de résidences démontables installées sur un même terrain ainsi que de leurs surfaces.
Dans le cas de l’installation d’une seule résidence démontable, c’est le droit commun qui s’applique (articles R421-14 et R421-17 du code de l’urbanisme) :
- Un déclaration préalable de travaux si la surface de plancher est entre 5 et 20m² (40m² en zone urbanisée)
- Un permis de construire si la surface de plancher est au-delà de 20m² (> 8 pièces réglementaires techniques)
Dans le cas de l’installation de 2 résidences démontables ou plus (article L444-1 du code de l’urbanisme) :
- Une déclaration préalable de travaux si la surface de plancher totale est inférieure à 40m²;
- Un permis d’aménager pour une surface totale de plancher de 40m² ou plus.
Les démarches d’autorisation d’urbanisme
Pour toute installation ou construction d’un habitat, une démarche d’autorisation d’urbanisme doit être déposée auprès des services instructeurs de votre commune. L'instruction des permis et des autres actes est faite par les services de la commune ou de l'EPCI compétent (Établissement public de coopération intercommunale) comme, par exemple, la communauté de communes.Les autorisations d’urbanisme à solliciter pour l’installation d’une résidence démontable constituant l’habitat permanent de ses utilisateurs varient en fonction du nombre de résidences démontables installées sur un même terrain ainsi que de leurs surfaces.
Dans le cas de l’installation d’une seule résidence démontable, c’est le droit commun qui s’applique (articles R421-14 et R421-17 du code de l’urbanisme) :
- Un déclaration préalable de travaux si la surface de plancher est entre 5 et 20m² (40m² en zone urbanisée)
- Un permis de construire si la surface de plancher est au-delà de 20m² (> 8 pièces réglementaires techniques)
Dans le cas de l’installation de 2 résidences démontables ou plus (article L444-1 du code de l’urbanisme) :
- Une déclaration préalable de travaux si la surface de plancher totale est inférieure à 40m²;
- Un permis d’aménager pour une surface totale de plancher de 40m² ou plus.

Inscrire l’habitat réversible ou le hameau léger dans le document d’urbanisme local
Identifier un terrain adapté ou une commune engagée

Il est important de comprendre que l’objectif des documents d’urbanisme est de minimiser les déplacements et les réseaux, limiter l’artificialisation des sols et protéger les espaces naturels, agricoles, forestiers et la biodiversité.
Dans cette logique, les collectivités territoriales cherchent à éviter le “mitage”, c’est à dire la création d’espaces urbanisés en pleine nature. Il sera donc difficile, voire impossible, d’obtenir une autorisation d’installer un habitat réversible sur un terrain qui n’est proche d’aucune construction existante.
De même, il est nécessaire que le terrain envisagé ne se situe pas dans une zone à risques(inondations, incendies, glissements de terrain, …). Pour connaître les risques existants, consultez le PPR (plan de prévention des risques), s’il existe, ou adressez-vous à la mairie.
Si le terrain n’est pas déjà classé constructible ou STECAL (Secteur de Taille et de Capacité d'Accueil Limitée) autorisant l’installation de résidences démontables, il vous faudra convaincre la commune de modifier le plan d’urbanisme (voir plus bas).
Si vous n’avez pas de terrain identifié, il est souvent plus facile de commencer par trouverune commune volontaire pour accueillir votre projet, puis de lui demander de l’aide pour trouver un terrain adapté : les communes ont en effet souvent des terrains dont elles sont propriétaires ou peuvent en acquérir facilement grâce à leurs réseaux et à des outils comme les établissements publics fonciers (EPF).
L’idéal est de trouver une commune engagée dans un processus de révision de son plan local d’urbanisme (PLU) ou de création d’un PLU intercommunal (PLUi).
Il est également plus facile de s’adresser à des communes déjà engagées dans une démarche écologique ou sociale, certaines sont répertoriées sur notre carte collaborative consultable ici.
Obtenir le soutien des élu·es

Pour convaincre les élu·es d’intégrer l’habitat réversible, il est important de mettre en valeur l’intérêt pour la commune et en cela un projet collectif comme un hameau léger est souvent plus facile à présenter.
En voici quelques exemples :
- Attirer des jeunes et des familles afin de rajeunir la population et éviter la fermeture de classes d’école ;
- Accueillir de nouvelles activités économiques, artisanales ou associatives, et consoliderles activités existantes par l’augmentation de la consommation locale ;
- Permettre l’accès au logement à des foyers ayant des difficultés à se loger en raison de la pression foncière ;
- Réaliser un projet innovant et écologique et développer l’attractivité de sa commune et du territoire ;
- Offrir la possibilité de vivre légalement en résidence démontable à des personnes qui choisissent ce mode de vie, souvent forcées de s’installer illégalement faute de zones dédiées dans les PLU, malgré la loi ALUR de 2014.
Il est également important d’anticiper les peurs et interrogations courantes des élu·es.
En voici quelques unes :
- L’arrivée d’une population précaire, qui ne travaillent pas et s’insèrent difficilement au tissu local : “cas sociaux”, “secte”, “ghetto”, “fumeurs de haschich”* ;
- L’installation de logements “moches”*, peu qualitatifs (précarité/insalubrité) qui ne s’intègrent pas au paysage local (ex : caravanes) ;
- Une perte de temps avec des personnes qui ne sont pas sérieuses/n’ont pas conscience de ce que c’est que la ruralité, qui ne s’inscrivent pas dans la durée ;
- Une interrogation sur la scolarisation des enfants, etc.
Retrouvez nos conseils sur la présentation Conseils pour se mettre dans la peau d'un·e élu·e.
La réalisation d’un dossier de présentation et des rencontres en présentiel peuvent permettre de rassurer les élu·es. Il est également recommandé d’être soutenu par des personnes de la commune ou de structures comme la communauté de communes, le pôle d'équilibre territorial et rural (PETR), le Parc Naturel Régional, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE), etc.
Des conseils vous sont partagés depuis ces deux présentations :
- Conseils pour présenter son projet aux élu·es
- Conseils pour préparer un dossier de présentation de hameau léger
*termes entendus par l’équipe Hameaux Légers lors d’entretiens avec les élu·es
Inscrire le projet dans le plan d’urbanisme

Une fois la commune convaincue, il existe trois procédures pour autoriserl’installation de résidences démontables dans un PLU / PLUi :
- Création (procédure qui dure 3 à 5 ans) ;
- Révision (1 à 2 ans) - l’ensemble du document est refondu ;
- Modification simplifiée (5 à 9 mois) - seuls certains zonages sont modifiés.
Si la commune est déjà engagée dans une procédure de création (durée de 3 à 5 ans) ou de révision (1 à 2 ans) du PLU ou PLUi, il est possible d’intervenir à chaque étape de sa réalisation :
- Diagnostic : faire recenser le besoin d’installer des habitats réversibles ;
- Plan d’aménagement et de développement durable (PADD) : inscrire l’habitat réversible comme une stratégie pour répondre notamment aux besoins des jeunes foyers et expérimenter des modes de construction et d’habitat écologiques ;
- Règlement : créer un ou plusieurs STECAL pour résidences démontables et/ou faire une OAP (orientation d’aménagement et de programmation) pour réserver une zone constructible à des résidences démontables.
Dans le cas contraire, la commune peut réaliser une modification simplifiée de son PLU concernant une ou plusieurs zones uniquement, procédure assez rapide (5 à 9 mois) et peu coûteuse.
Zoom sur le STECAL
Les STECAL sont des secteurs délimités dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, pour y accueillir des installations/constructions spécifiques. Il s’agit d’une dérogation au principe de non-constructibilité subordonnée au respect des principes suivants :
- protection des espaces naturels, agricoles et forestiers,
- préservation et remise en bon état des continuités écologiques,
- consommation raisonnée des terres,
- réduction des flux de déplacements,
- répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services.
Les STECAL peuvent accueillir tout type de construction précisé dans le PLU, de nombreux STECAL existent pour des activités économiques, touristiques ou encore pour de l’habitat traditionnel, mais très peu pour de l’habitat réversible.
L’obtention d’un STECAL peut être une procédure longue et reste validée à titre exceptionnel.
Nous vous conseillons une installation :
- de préférence sur des terrains en continuité urbaine
- hors des zones de risques (inondations, glissement de terrain, ...) définies dans le PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondations)
Le STECAL est validé à titre exceptionnel avec l'accord du préfet et après avis de la CDPENAF (Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers).
Inscrire l’habitat réversible ou le hameau léger dans le document d’urbanisme local
Identifier un terrain adapté ou une commune engagée

Il est important de comprendre que l’objectif des documents d’urbanisme est de minimiser les déplacements et les réseaux, limiter l’artificialisation des sols et protéger les espaces naturels, agricoles, forestiers et la biodiversité.
Dans cette logique, les collectivités territoriales cherchent à éviter le “mitage”, c’est à dire la création d’espaces urbanisés en pleine nature. Il sera donc difficile, voire impossible, d’obtenir une autorisation d’installer un habitat réversible sur un terrain qui n’est proche d’aucune construction existante.
De même, il est nécessaire que le terrain envisagé ne se situe pas dans une zone à risques(inondations, incendies, glissements de terrain, …). Pour connaître les risques existants, consultez le PPR (plan de prévention des risques), s’il existe, ou adressez-vous à la mairie.
Si le terrain n’est pas déjà classé constructible ou STECAL (Secteur de Taille et de Capacité d'Accueil Limitée) autorisant l’installation de résidences démontables, il vous faudra convaincre la commune de modifier le plan d’urbanisme (voir plus bas).
Si vous n’avez pas de terrain identifié, il est souvent plus facile de commencer par trouverune commune volontaire pour accueillir votre projet, puis de lui demander de l’aide pour trouver un terrain adapté : les communes ont en effet souvent des terrains dont elles sont propriétaires ou peuvent en acquérir facilement grâce à leurs réseaux et à des outils comme les établissements publics fonciers (EPF).
L’idéal est de trouver une commune engagée dans un processus de révision de son plan local d’urbanisme (PLU) ou de création d’un PLU intercommunal (PLUi).
Il est également plus facile de s’adresser à des communes déjà engagées dans une démarche écologique ou sociale, certaines sont répertoriées sur notre carte collaborative consultable ici.
Obtenir le soutien des élu·es

Pour convaincre les élu·es d’intégrer l’habitat réversible, il est important de mettre en valeur l’intérêt pour la commune et en cela un projet collectif comme un hameau léger est souvent plus facile à présenter.
En voici quelques exemples :
- Attirer des jeunes et des familles afin de rajeunir la population et éviter la fermeture de classes d’école ;
- Accueillir de nouvelles activités économiques, artisanales ou associatives, et consoliderles activités existantes par l’augmentation de la consommation locale ;
- Permettre l’accès au logement à des foyers ayant des difficultés à se loger en raison de la pression foncière ;
- Réaliser un projet innovant et écologique et développer l’attractivité de sa commune et du territoire ;
- Offrir la possibilité de vivre légalement en résidence démontable à des personnes qui choisissent ce mode de vie, souvent forcées de s’installer illégalement faute de zones dédiées dans les PLU, malgré la loi ALUR de 2014.
Il est également important d’anticiper les peurs et interrogations courantes des élu·es.
En voici quelques unes :
- L’arrivée d’une population précaire, qui ne travaillent pas et s’insèrent difficilement au tissu local : “cas sociaux”, “secte”, “ghetto”, “fumeurs de haschich”* ;
- L’installation de logements “moches”*, peu qualitatifs (précarité/insalubrité) qui ne s’intègrent pas au paysage local (ex : caravanes) ;
- Une perte de temps avec des personnes qui ne sont pas sérieuses/n’ont pas conscience de ce que c’est que la ruralité, qui ne s’inscrivent pas dans la durée ;
- Une interrogation sur la scolarisation des enfants, etc.
Retrouvez nos conseils sur la présentation Conseils pour se mettre dans la peau d'un·e élu·e.
La réalisation d’un dossier de présentation et des rencontres en présentiel peuvent permettre de rassurer les élu·es. Il est également recommandé d’être soutenu par des personnes de la commune ou de structures comme la communauté de communes, le pôle d'équilibre territorial et rural (PETR), le Parc Naturel Régional, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE), etc.
Des conseils vous sont partagés depuis ces deux présentations :
- Conseils pour présenter son projet aux élu·es
- Conseils pour préparer un dossier de présentation de hameau léger
*termes entendus par l’équipe Hameaux Légers lors d’entretiens avec les élu·es
Inscrire le projet dans le plan d’urbanisme

Une fois la commune convaincue, il existe trois procédures pour autoriserl’installation de résidences démontables dans un PLU / PLUi :
- Création (procédure qui dure 3 à 5 ans) ;
- Révision (1 à 2 ans) - l’ensemble du document est refondu ;
- Modification simplifiée (5 à 9 mois) - seuls certains zonages sont modifiés.
Si la commune est déjà engagée dans une procédure de création (durée de 3 à 5 ans) ou de révision (1 à 2 ans) du PLU ou PLUi, il est possible d’intervenir à chaque étape de sa réalisation :
- Diagnostic : faire recenser le besoin d’installer des habitats réversibles ;
- Plan d’aménagement et de développement durable (PADD) : inscrire l’habitat réversible comme une stratégie pour répondre notamment aux besoins des jeunes foyers et expérimenter des modes de construction et d’habitat écologiques ;
- Règlement : créer un ou plusieurs STECAL pour résidences démontables et/ou faire une OAP (orientation d’aménagement et de programmation) pour réserver une zone constructible à des résidences démontables.
Dans le cas contraire, la commune peut réaliser une modification simplifiée de son PLU concernant une ou plusieurs zones uniquement, procédure assez rapide (5 à 9 mois) et peu coûteuse.
Zoom sur le STECAL
Les STECAL sont des secteurs délimités dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, pour y accueillir des installations/constructions spécifiques. Il s’agit d’une dérogation au principe de non-constructibilité subordonnée au respect des principes suivants :
- protection des espaces naturels, agricoles et forestiers,
- préservation et remise en bon état des continuités écologiques,
- consommation raisonnée des terres,
- réduction des flux de déplacements,
- répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services.
Les STECAL peuvent accueillir tout type de construction précisé dans le PLU, de nombreux STECAL existent pour des activités économiques, touristiques ou encore pour de l’habitat traditionnel, mais très peu pour de l’habitat réversible.
L’obtention d’un STECAL peut être une procédure longue et reste validée à titre exceptionnel.
Nous vous conseillons une installation :
- de préférence sur des terrains en continuité urbaine
- hors des zones de risques (inondations, glissement de terrain, ...) définies dans le PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondations)
Le STECAL est validé à titre exceptionnel avec l'accord du préfet et après avis de la CDPENAF (Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers).

Le permis d’aménager pour résidences démontables

Dans le cadre d’installation d’un hameau léger et donc de plus de 2 résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, il s’agit de déposer un permis d’aménager, sans dépôt de permis de construire pour les habitats réversibles individuels.
Le permis d’aménager pour installer des résidences démontables est une démarche plus souple que le permis de construire, étant donné qu’il n’est pas requis de fournir une description précise ou des croquis des habitats qui seront installés mais de définir des zones d’implantation, comme pour un camping, ainsi que les éventuels réseaux et voiries qui seront aménagés. Il est donc préférable de demander l’aménagement de 2 résidences ou plus.
La demande de permis d’aménager s’effectue au moyen du formulaire Cerfa n° 1340906, et le délai de réponse est généralement de 3 mois à partir de la date du dépôt de la demande.Une fois le permis obtenu, les tiers disposent d’un délai de 2 mois pour effectuer un recours, à compter de la date de début d'affichage de l'autorisation d'urbanisme sur le terrain.Il est important d’effectuer l'affichage selon des formalités très précises (contenu, lisibilité, visibilité) pendant 2 mois continus et fortement recommandé de le faire constater par un huissier pour limiter les risques de contestation.
Pour approfondir ce sujet, nous vous recommandons de consulter le Webinaire : Obtenir un permis d’aménager organisé le 8 février 2023. Vous trouverez une présentation détaillée sur le permis d'aménager ainsi que l'enregistrement du webinaire.
Si la commune vous demande un permis de construire alors que votre terrain est en zone 1AU, c'est que les élus ou les services techniques ne connaissent pas le cas particulier des résidences démontables constituant des habitations permanentes. Nous vous conseillons de les sensibiliser à cette question, de les renvoyer vers des ressources de Hameaux Légers, ou de vous retourner vers la Direction Départementale des Territoires (et de la Mer), DDT ou DDTM en fonction de votre localisation.
La réglementation architecturale et paysagère
Le document d’urbanisme aborde certains éléments pour garantir une harmonie architecturale et paysagère sur la commune. Différents sujets sont mentionnés au sein du PLU(i) : la hauteur du bâti, sa surface, l’emprise au sol (afin de préserver la vocation du sol en imposant un pourcentage de pleine terre), les matériaux utilisés, les toitures (pentes de toit imposées) ou encore l'autonomie aux réseaux.
Les articles du règlement liés aux règles d'architecture, avec par exemple, un angle de pente de toit peut alors exclure des typologies d’habitat réversible comme la yourte. À ce titre, il est important de se rappeler :
- Un PLU(i) ne peut pas imposer des matériaux de construction ;
- Un PLU(i) peut imposer des "aspects" extérieurs notamment des teintes de mur.
⚠️ Bon à savoir : Dans les articles liés à l'aspect architectural, il est fréquent de retrouver un texte sur l'insertion harmonieuse avec le voisinage. Cette mention reste floue et peut être interprétée différemment mais peut servir d'argument pour les services instructeurs pour empêcher l'implantation d’un habitat alternatif. Il convient de parcourir le règlement avec attention.
Dans le cas d’une installation sur un secteur protégé, un Architecte des Bâtiments de France (ABF) est sollicité et donne son accord ou simple avis l’installation ou la construction d’un projet.
Sur une zone couverte par l’ABF avec co-visibilité*, l'ABF peut émettre son véto sur l'acceptation d'un permis de construire ou d’un permis d’aménager. Si la co-visibilité n’est pas avérée, l’ABF n'a qu'un avis consultatif. Le maire de la commune peut alors valider le permis malgré un avis défavorable de l'ABF.
📝 Définition : La zone de co-visibilité est définie si, même en dehors du périmètre de protection, à l’œil nu et depuis une zone normalement accessible au public :
- la zone protégée est visible simultanément au projet étudié ;
- le projet étudié est visible depuis la zone protégée.
Une bonne relation avec l'ABF est primordiale, il peut être un interlocuteur influent auprès des services d'urbanisme de l'intercommunalité !
Sur le plan patrimonial, il faudra aussi respecter les préconisations, en cas de zone de présomption archéologique, de protection régionale, de mesure du PNR etc.
Le permis d’aménager pour résidences démontables

Dans le cadre d’installation d’un hameau léger et donc de plus de 2 résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, il s’agit de déposer un permis d’aménager, sans dépôt de permis de construire pour les habitats réversibles individuels.
Le permis d’aménager pour installer des résidences démontables est une démarche plus souple que le permis de construire, étant donné qu’il n’est pas requis de fournir une description précise ou des croquis des habitats qui seront installés mais de définir des zones d’implantation, comme pour un camping, ainsi que les éventuels réseaux et voiries qui seront aménagés. Il est donc préférable de demander l’aménagement de 2 résidences ou plus.
La demande de permis d’aménager s’effectue au moyen du formulaire Cerfa n° 1340906, et le délai de réponse est généralement de 3 mois à partir de la date du dépôt de la demande.Une fois le permis obtenu, les tiers disposent d’un délai de 2 mois pour effectuer un recours, à compter de la date de début d'affichage de l'autorisation d'urbanisme sur le terrain.Il est important d’effectuer l'affichage selon des formalités très précises (contenu, lisibilité, visibilité) pendant 2 mois continus et fortement recommandé de le faire constater par un huissier pour limiter les risques de contestation.
Pour approfondir ce sujet, nous vous recommandons de consulter le Webinaire : Obtenir un permis d’aménager organisé le 8 février 2023. Vous trouverez une présentation détaillée sur le permis d'aménager ainsi que l'enregistrement du webinaire.
Si la commune vous demande un permis de construire alors que votre terrain est en zone 1AU, c'est que les élus ou les services techniques ne connaissent pas le cas particulier des résidences démontables constituant des habitations permanentes. Nous vous conseillons de les sensibiliser à cette question, de les renvoyer vers des ressources de Hameaux Légers, ou de vous retourner vers la Direction Départementale des Territoires (et de la Mer), DDT ou DDTM en fonction de votre localisation.
La réglementation architecturale et paysagère
Le document d’urbanisme aborde certains éléments pour garantir une harmonie architecturale et paysagère sur la commune. Différents sujets sont mentionnés au sein du PLU(i) : la hauteur du bâti, sa surface, l’emprise au sol (afin de préserver la vocation du sol en imposant un pourcentage de pleine terre), les matériaux utilisés, les toitures (pentes de toit imposées) ou encore l'autonomie aux réseaux.
Les articles du règlement liés aux règles d'architecture, avec par exemple, un angle de pente de toit peut alors exclure des typologies d’habitat réversible comme la yourte. À ce titre, il est important de se rappeler :
- Un PLU(i) ne peut pas imposer des matériaux de construction ;
- Un PLU(i) peut imposer des "aspects" extérieurs notamment des teintes de mur.
⚠️ Bon à savoir : Dans les articles liés à l'aspect architectural, il est fréquent de retrouver un texte sur l'insertion harmonieuse avec le voisinage. Cette mention reste floue et peut être interprétée différemment mais peut servir d'argument pour les services instructeurs pour empêcher l'implantation d’un habitat alternatif. Il convient de parcourir le règlement avec attention.
Dans le cas d’une installation sur un secteur protégé, un Architecte des Bâtiments de France (ABF) est sollicité et donne son accord ou simple avis l’installation ou la construction d’un projet.
Sur une zone couverte par l’ABF avec co-visibilité*, l'ABF peut émettre son véto sur l'acceptation d'un permis de construire ou d’un permis d’aménager. Si la co-visibilité n’est pas avérée, l’ABF n'a qu'un avis consultatif. Le maire de la commune peut alors valider le permis malgré un avis défavorable de l'ABF.
📝 Définition : La zone de co-visibilité est définie si, même en dehors du périmètre de protection, à l’œil nu et depuis une zone normalement accessible au public :
- la zone protégée est visible simultanément au projet étudié ;
- le projet étudié est visible depuis la zone protégée.
Une bonne relation avec l'ABF est primordiale, il peut être un interlocuteur influent auprès des services d'urbanisme de l'intercommunalité !
Sur le plan patrimonial, il faudra aussi respecter les préconisations, en cas de zone de présomption archéologique, de protection régionale, de mesure du PNR etc.

Les normes d’hygiène et de sécurité
Réseaux et hygiène
L’option de l’autonomie
L'article R.111-46-1 du code de l’urbanisme prévoit que les résidences démontables peuvent être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Attention, la plupart du temps les communs n’ont pas ce statut et sont de surcroît des biens immeubles, devant être raccordés au réseau dans les zones qu’il dessert.
Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, tout moment, facilement et rapidement démontables.
Si vous souhaitez être raccordé à tout ou partie des réseaux publics
Que l’on parle d’un permis d’aménager ou d’un permis de construire, l'article L.111-11 du code de l'urbanisme prévoit la possibilité de refuser votre demande d’autorisation, si la collectivité ne peut garantir la présence des réseaux publics dans un délai compatible avec la réalisation de la construction. Il y est spécifiquement précisé ceci s’applique aussi “aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.”
Si vous souhaitez être en autonomie partielle ou totale
Si vous faite une demande de permis d’aménager pour résidences démontables, l'article R.441-6-1 du code de l’urbanisme précise le cadre réglementaire : une attestation est à fournir lors de la demande, et les conditions du PLU prévalent.
Lorsque la demande porte sur l'aménagement d'un terrain en vue de l'installation de résidences démontables définies à l'article R. 111-46-1, constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs et disposant d'équipements non raccordés aux réseaux publics, le demandeur joint à son dossier, en application de l'article L. 111-4, une attestation permettant de s'assurer du respect des règles d'hygiène et de sécurité, notamment de sécurité contre les incendies, ainsi que des conditions dans lesquelles sont satisfaits les besoins des occupants en eau, assainissement et électricité. Ces conditions sont fixées, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme, notamment dans les secteurs délimités en application du 6° du II de l'article L. 123-1-5. Cette attestation est fournie sous la responsabilité du demandeur.
Attention, l’avant dernière phrase précise bien que le plan local d’urbanisme prévaut, s’il traite de ces sujets.
Si vous faites une demande de permis de construire pour une seule résidence démontable, un bâtiment commun etc., le droit commun s’applique. Le raccordement est possible sous conditions (assainissement, eau potable, électricité), et obligatoire dans certains cas (assainissement, eau potable). Il faudra joindre des pièces justificatives de conformité à votre demande en cas de non raccordement au réseau d’assainissement, et réaliser certaines démarches en cas d’approvisionnement individuel en eau potable.
Attestation de respect des règles d’hygiène et de sécurité
L’attestation certifiant le respect des règles d’hygiène et de sécurité, à fournir lors d’une demande de permis d’aménager, doit être accompagnée du détail des conditions de traitement de :
- L’alimentation en eau potable
- L’assainissement, dont les toilettes sèches et le compostage lié
- La gestion des déchets, dont le compostage
- Le risque incendie
- L’électricité
- Le stationnement et circulation
Vous trouverez à partir de ce lien un exemple d’attestation et de justifications.
Eau potable
Il n’est pas obligatoire de se raccorder au réseau public d’eau potable si l’on dispose d’un puit ou d’un forage, mais la collecte d’eau de pluie à usage de consommation est interdite. Dans le cas d’un approvisionnement individuel, il faut informer l’ARS (Agence Régionale de Santé), la préfecture et les services locaux de gestion de l’eau et de l’assainissement.
Il n’est pas non plus obligatoire pour la collectivité d’autoriser le raccordement, sauf dans les zones desservies par le réseau de distribution. Les travaux de raccordement sont à la charge de la collectivité uniquement sur l’espace public desservi par le réseau.
Aussi, si les habitats ne sont pas raccordés individuellement, il sera nécessaire de préciser comment l’approvisionnement est effectué (contenants, méthode, hygiène …).
Assainissement
Le raccordement est obligatoire pour les immeubles (article L1331-1, CSP) qui ont un accès au réseau d'assainissement public, et la demande de raccordement reste possible dans le cas contraire. Il faudra cependant prendre en charge les travaux d'extension du réseau en domaine public, ainsi que payer la redevance d'assainissement collectif et l’éventuelle participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC ou PAC).
Ceci concerne fréquemment les espaces communs, mais normalement pas les habitats, biens meubles (Articles 517 à 526, code civil, Article L111-1 CU, fiche Cerema).
En cas d’impossibilité technique ou de surcoût excessif, il est possible de faire une demande de dérogation notamment en cas de surcoût du raccordement, comme le précise l’arrêté du 19 juillet 1960,
L’arrêté du 19 juillet 1960 relatif aux raccordements des immeubles aux égouts (application de l'article L. 33 du Code de la santé publique) précise “peuvent être exonérés de l'obligation de raccordement aux égouts prévue au premier alinéa de l'article 33 du Code de la santé publique […] les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome recevant l'ensemble des eaux usées domestiques et conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 mars 1982.”
Le Ministère de la Transition Écologique répond à la question du Sénat que “les deux critères principaux pour décider si une maison est raccordable ou non au réseau d'assainissement collectif sont d'une part, le coût du raccordement et d'autre part, la faisabilité technique” et que “par exemple, si le coût du raccordement de l'habitation au réseau de collecte des eaux usées est supérieur au coût d'un assainissement non collectif, il convient de maintenir ladite habitation en zone d'assainissement non collectif”.
En cas de non raccordement, le SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif) fait autorité et fournit une attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif.
Le cadre réglementaire dépendra du SPANC local mais les thématiques abordées seront généralement la perméabilité du sol, la gestion des rejets, y compris lors d’intempéries, et la distance aux zones à enjeux sanitaires ou environnementaux, arbres, limites de propriétés.
Concernant l’épuration, il faudra s’orienter vers des systèmes agréés, (qu’il s’agisse de phyto- ou pédo-épuration, d’une fosse septique, etc.) ou demander une dérogation.
Concernant les toilettes sèches et leur compostage, la vigilance est plus importante que pour un compost classique, et l’acceptabilité publique moins acquise a priori. Il faudra notamment éviter toute nuisance, comme les écoulements aux abords du site de compostage et les contaminations des eaux superficielles et souterraines.
Ainsi il conviendra d’installer le compost à distance des zones sensibles (zones de vie, espaces naturels fragiles, eaux, etc.), de le contenir avec parois latérales imperméables s’enfonçant dans le sol, et idéalement de prévoir une protection contre la pluie.
L’arrêté du 7 septembre 2009 éclaircit le cadre réglementaire :
Dans l’arrêté du 7 septembre 2009, modifié par arrêté le 7 mars 2012, les toilettes sèches “sont autorisées, à la condition qu'elles ne génèrent aucune nuisance pour le voisinage ni rejet liquide en dehors de la parcelle, ni pollution des eaux superficielles ou souterraines. […] Les sous-produits issus de l'utilisation de toilettes sèches et après compostage doivent être valorisés sur la parcelle et ne générer aucune nuisance pour le voisinage, ni pollution.”
L’arrêté du 27 avril 2012, en annexe 3, précise les prescriptions techniques importantes :
- l'adaptation de l'installation retenue au type d'usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l'immeuble desservi ;
- la vérification de l'étanchéité de la cuve recevant les fèces et/ou les urines ;
- le respect des règles d'épandage et de valorisation des déchets des toilettes sèches ;
- l'absence de nuisance pour le voisinage et de pollution visible ;
- la vérification de la présence d'une installation de traitement des eaux ménagères.
Ce guide du ministère, destiné aux SPANC, va plus loin.
Concernant l’adaptation de l’installation : “vérifier la cohérence” de l’ensemble, et concernant l’aire de compostage, “Vérifier que les phénomènes de ruissellement ont bien été pris en compte …. Vérifier la protection contre les intempéries …. Vérifier l’absence de rejet direct au milieu hydraulique superficiel. Vérifier la capacité des bacs.”
Concernant la vérification de l’étanchéité de la cuve recevant les fèces et/ou les urines, le contrôle consiste à “dans les toilettes, vérifier que le réceptacle des résidus […] est étanche. […] Sur l’aire de compostage : dans les zones à enjeux sanitaire ou environnemental, vérifier l’étanchéité de l’aire de compostage (notamment à proximité des ressources en eau potable).”
Et les zones à enjeu sanitaire ou environnemental sont décrites comme suit :
- Périmètres de protection de captages,
- Zones à usage sensible de l’eau : captage d'alimentation en eau potable (AEP), baignade, activités nautiques, conchyliculture, pisciculture, cressiculture, pêche à pied (contraintes sanitaires),
- Zone définie par arrêté du maire ou du préfet dans laquelle l’assainissement non collectif (ANC) a un impact sanitaire sur un usage sensible,
- Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) / Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE),
- Présence de puits déclarés et utilisés pour l’alimentation en eau potable (contraintes sanitaires).
En résumé, l’aire de compostage ne doit pas être étanche sauf en zone à enjeu sanitaire ou environnemental, mais le SPANC doit vérifier que le système de compostage est adapté au milieu et ses spécificités, et au(x) foyers producteurs. Les points d’attention sont le ruissellement, la protection contre les intempéries, et le dimensionnement des équipements.
Et encore, dans ces zones, selon la proximité de la zone sensible, et les capacités du sol, certains acteurs préconisent une étanchéité latérale et sur une vingtaine de centimètres de profondeur, mais pas d’étanchéité complète.
Des bonnes pratiques sont référencées dans ces ressources :
- Guide du Réseau d’Assainissement Écologique
- Préconisations pour toilettes sèches domestiques de l’ADEME
Électricité
Lors de la construction, rénovation ou extension de tout bâtiment d’habitation, les propriétaires doivent respecter la norme électrique NFC 15-100, comme précisé dans l’arrêté du 3 août 2016 portant sur la réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation.
C’est le CONSUEL (Comité National pour la Sécurité des Usagers de l’Électricité) qui délivre l’attestation du même nom, notamment nécessaire pour toute habitation cédée ou louée, et pour le raccord au réseau public, que ce soit pour la consommation ou la production.
Au sens strict, un bâtiment est défini comme construction à usage d’habitation , ce qui exclut les installations comme les résidences démontables.
Cependant, certaines assurances habitation demandent de fournir cette attestation. Aussi, en cas d’envoi d’électricité sur le réseau, le CONSUEL est nécessaire. En cas de souscription d’un abonnement spécifiquement pour un habitat, il peut être difficile d’obtenir l’autorisation du gestionnaire de réseau.
L’approvisionnement en électricité est un critère de décence, ce qui est important en cas de location, d’accès aux prestations sociales etc. Mais le raccordement au réseau d’électricité est un droit (sauf en cas d’impossibilité technique) et non un devoir.
Compost des déchets domestiques
On distingue deux méthodes de compostage dans le cadre d’un hameau léger :
- les composts particuliers, lorsque chaque habitat dispose de son propre compost ;
- le compost de proximité, lorsque le hameau dispose d’un compost collectif.
La réglementation est très peu détaillée pour les composts alimentaires de particuliers. En effet, aucune démarche spécifique n’est nécessaire en dessous d’un volume de 5m³. Si un compost dépasse ce volume, il est recommandé de respecter une distance de 200m minimum par rapport aux premières habitations.
Cependant, il est bon de veiller à éviter les nuisances, en installant notamment son compost à distance des habitations du projet et du voisinage, et en respectant les bonnes pratiques liées au compostage.
L’arrêté du 9 avril 2018 présente, dans les articles 17 à 21 (source legifrance), le statut juridique du compostage de proximité. Ce dernier doit être réalisé sur place et pour un usage local, et ne doit pas dépasser 1 tonne de déchets produits par semaine. Si les quantités produites hebdomadairement dépassent cette valeur, se référer à l’article 21 pour une éventuelle dérogation.
Une personne physique ou morale alors être alors désignée comme responsable de la bonne gestion du compost (manipulation, prévention des risques de contamination, bonne montée en température, etc.).
Concernant les déchets non compostés, il faudra prévoir un stockage dans des conditions d’hygiène satisfaisantes et dans un lieu accessible aux services de collecte. Il faudra aussi s’assurer de leur possibilité de collecte par la collectivité compétente, à savoir la Mairie ou l’EPCI ayant cette compétence.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16217
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006143752/
Sécurité
Risque incendie
La compétence incendie est portée par la commune, qui doit s’assurer du respect des règles concernant la distance à la borne incendie, souvent 400m, et des accès des véhicules d’intervention (largeur, portance, rayon de braquage des voies d’accès). Dans certains cas, il est possible d’utiliser une réserve incendie sous forme de poches ou retenues d’eau.
Les règles spécifiques dépendent du SDIS local (pompiers) et sont soumises à l’appréciation du responsable prévention, qui peut, au cas par cas, faire des exceptions. Les sujets restent similaires :
- Distance entre les bâtiments, installations et la borne.
- Distance entre les bâtiments, installations et le camion d'intervention (utilisation de dévidoirs possibles).
- Portance, largeur, longueur des voies d'accès.
- Aire de retournement.
- Statut des bâtiments et installations, notamment ERP, cf. plus bas.
- Débit de la borne.
Les caractéristiques techniques du bâtiment n’impliquent pas nécessairement les mêmes exigences que son usage. Un bâtiment commun de plein pied et non mitoyen peut par exemple être considéré comme habitat individuel ne nécessitant pas de solliciter le SDIS, mais être classifié ERP (Établissement Recevant du Public), ce qui impose des normes supplémentaires mentionnées plus bas.
Stationnement et circulations
Ce sujet aussi dépend du contexte local, mais il conviendra de préciser comment s’effectue la circulation vers et depuis le projet, ses voies d’accès et zones de stationnement.
Il faudra prêter attention à la sécurité des manœuvres et notamment de la visibilité nécessaire à leur réalisation (marche avant, vue dégagée, etc.).
Aussi, il convient de s’assurer des obligations en termes de nombre de place de stationnement, précisées dans les documents d’urbanisme.
ERP (Établissement Recevant du Public)
Le bâtiment commun peut, selon son usage, sa destination au sens de l’urbanisme, et la position des services techniques instruisant la demande, être soumis aux normes ERP, déclinés en termes d’accessibilité et de prévention du risque incendie. Ces normes peuvent être fortement impactantes en termes de budget et de programme architectural.
Il faut se rapprocher de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) pour l’accessibilité et du SDIS (pompiers) pour le sujet incendie, et détailler l’usage du bâtiment, car il conditionne l’assujettissement. Si nécessaire, il faut justifier sa position dans le dossier d’instruction. Aussi, il peut être bon de contacter le bureau de contrôle de légalité de la préfecture, qui se prononce en fin d’instruction.
Les normes d’hygiène et de sécurité
Réseaux et hygiène
L’option de l’autonomie
L'article R.111-46-1 du code de l’urbanisme prévoit que les résidences démontables peuvent être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Attention, la plupart du temps les communs n’ont pas ce statut et sont de surcroît des biens immeubles, devant être raccordés au réseau dans les zones qu’il dessert.
Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, tout moment, facilement et rapidement démontables.
Si vous souhaitez être raccordé à tout ou partie des réseaux publics
Que l’on parle d’un permis d’aménager ou d’un permis de construire, l'article L.111-11 du code de l'urbanisme prévoit la possibilité de refuser votre demande d’autorisation, si la collectivité ne peut garantir la présence des réseaux publics dans un délai compatible avec la réalisation de la construction. Il y est spécifiquement précisé ceci s’applique aussi “aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.”
Si vous souhaitez être en autonomie partielle ou totale
Si vous faite une demande de permis d’aménager pour résidences démontables, l'article R.441-6-1 du code de l’urbanisme précise le cadre réglementaire : une attestation est à fournir lors de la demande, et les conditions du PLU prévalent.
Lorsque la demande porte sur l'aménagement d'un terrain en vue de l'installation de résidences démontables définies à l'article R. 111-46-1, constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs et disposant d'équipements non raccordés aux réseaux publics, le demandeur joint à son dossier, en application de l'article L. 111-4, une attestation permettant de s'assurer du respect des règles d'hygiène et de sécurité, notamment de sécurité contre les incendies, ainsi que des conditions dans lesquelles sont satisfaits les besoins des occupants en eau, assainissement et électricité. Ces conditions sont fixées, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme, notamment dans les secteurs délimités en application du 6° du II de l'article L. 123-1-5. Cette attestation est fournie sous la responsabilité du demandeur.
Attention, l’avant dernière phrase précise bien que le plan local d’urbanisme prévaut, s’il traite de ces sujets.
Si vous faites une demande de permis de construire pour une seule résidence démontable, un bâtiment commun etc., le droit commun s’applique. Le raccordement est possible sous conditions (assainissement, eau potable, électricité), et obligatoire dans certains cas (assainissement, eau potable). Il faudra joindre des pièces justificatives de conformité à votre demande en cas de non raccordement au réseau d’assainissement, et réaliser certaines démarches en cas d’approvisionnement individuel en eau potable.
Attestation de respect des règles d’hygiène et de sécurité
L’attestation certifiant le respect des règles d’hygiène et de sécurité, à fournir lors d’une demande de permis d’aménager, doit être accompagnée du détail des conditions de traitement de :
- L’alimentation en eau potable
- L’assainissement, dont les toilettes sèches et le compostage lié
- La gestion des déchets, dont le compostage
- Le risque incendie
- L’électricité
- Le stationnement et circulation
Vous trouverez à partir de ce lien un exemple d’attestation et de justifications.
Eau potable
Il n’est pas obligatoire de se raccorder au réseau public d’eau potable si l’on dispose d’un puit ou d’un forage, mais la collecte d’eau de pluie à usage de consommation est interdite. Dans le cas d’un approvisionnement individuel, il faut informer l’ARS (Agence Régionale de Santé), la préfecture et les services locaux de gestion de l’eau et de l’assainissement.
Il n’est pas non plus obligatoire pour la collectivité d’autoriser le raccordement, sauf dans les zones desservies par le réseau de distribution. Les travaux de raccordement sont à la charge de la collectivité uniquement sur l’espace public desservi par le réseau.
Aussi, si les habitats ne sont pas raccordés individuellement, il sera nécessaire de préciser comment l’approvisionnement est effectué (contenants, méthode, hygiène …).
Assainissement
Le raccordement est obligatoire pour les immeubles (article L1331-1, CSP) qui ont un accès au réseau d'assainissement public, et la demande de raccordement reste possible dans le cas contraire. Il faudra cependant prendre en charge les travaux d'extension du réseau en domaine public, ainsi que payer la redevance d'assainissement collectif et l’éventuelle participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC ou PAC).
Ceci concerne fréquemment les espaces communs, mais normalement pas les habitats, biens meubles (Articles 517 à 526, code civil, Article L111-1 CU, fiche Cerema).
En cas d’impossibilité technique ou de surcoût excessif, il est possible de faire une demande de dérogation notamment en cas de surcoût du raccordement, comme le précise l’arrêté du 19 juillet 1960,
L’arrêté du 19 juillet 1960 relatif aux raccordements des immeubles aux égouts (application de l'article L. 33 du Code de la santé publique) précise “peuvent être exonérés de l'obligation de raccordement aux égouts prévue au premier alinéa de l'article 33 du Code de la santé publique […] les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome recevant l'ensemble des eaux usées domestiques et conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 mars 1982.”
Le Ministère de la Transition Écologique répond à la question du Sénat que “les deux critères principaux pour décider si une maison est raccordable ou non au réseau d'assainissement collectif sont d'une part, le coût du raccordement et d'autre part, la faisabilité technique” et que “par exemple, si le coût du raccordement de l'habitation au réseau de collecte des eaux usées est supérieur au coût d'un assainissement non collectif, il convient de maintenir ladite habitation en zone d'assainissement non collectif”.
En cas de non raccordement, le SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif) fait autorité et fournit une attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif.
Le cadre réglementaire dépendra du SPANC local mais les thématiques abordées seront généralement la perméabilité du sol, la gestion des rejets, y compris lors d’intempéries, et la distance aux zones à enjeux sanitaires ou environnementaux, arbres, limites de propriétés.
Concernant l’épuration, il faudra s’orienter vers des systèmes agréés, (qu’il s’agisse de phyto- ou pédo-épuration, d’une fosse septique, etc.) ou demander une dérogation.
Concernant les toilettes sèches et leur compostage, la vigilance est plus importante que pour un compost classique, et l’acceptabilité publique moins acquise a priori. Il faudra notamment éviter toute nuisance, comme les écoulements aux abords du site de compostage et les contaminations des eaux superficielles et souterraines.
Ainsi il conviendra d’installer le compost à distance des zones sensibles (zones de vie, espaces naturels fragiles, eaux, etc.), de le contenir avec parois latérales imperméables s’enfonçant dans le sol, et idéalement de prévoir une protection contre la pluie.
L’arrêté du 7 septembre 2009 éclaircit le cadre réglementaire :
Dans l’arrêté du 7 septembre 2009, modifié par arrêté le 7 mars 2012, les toilettes sèches “sont autorisées, à la condition qu'elles ne génèrent aucune nuisance pour le voisinage ni rejet liquide en dehors de la parcelle, ni pollution des eaux superficielles ou souterraines. […] Les sous-produits issus de l'utilisation de toilettes sèches et après compostage doivent être valorisés sur la parcelle et ne générer aucune nuisance pour le voisinage, ni pollution.”
L’arrêté du 27 avril 2012, en annexe 3, précise les prescriptions techniques importantes :
- l'adaptation de l'installation retenue au type d'usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l'immeuble desservi ;
- la vérification de l'étanchéité de la cuve recevant les fèces et/ou les urines ;
- le respect des règles d'épandage et de valorisation des déchets des toilettes sèches ;
- l'absence de nuisance pour le voisinage et de pollution visible ;
- la vérification de la présence d'une installation de traitement des eaux ménagères.
Ce guide du ministère, destiné aux SPANC, va plus loin.
Concernant l’adaptation de l’installation : “vérifier la cohérence” de l’ensemble, et concernant l’aire de compostage, “Vérifier que les phénomènes de ruissellement ont bien été pris en compte …. Vérifier la protection contre les intempéries …. Vérifier l’absence de rejet direct au milieu hydraulique superficiel. Vérifier la capacité des bacs.”
Concernant la vérification de l’étanchéité de la cuve recevant les fèces et/ou les urines, le contrôle consiste à “dans les toilettes, vérifier que le réceptacle des résidus […] est étanche. […] Sur l’aire de compostage : dans les zones à enjeux sanitaire ou environnemental, vérifier l’étanchéité de l’aire de compostage (notamment à proximité des ressources en eau potable).”
Et les zones à enjeu sanitaire ou environnemental sont décrites comme suit :
- Périmètres de protection de captages,
- Zones à usage sensible de l’eau : captage d'alimentation en eau potable (AEP), baignade, activités nautiques, conchyliculture, pisciculture, cressiculture, pêche à pied (contraintes sanitaires),
- Zone définie par arrêté du maire ou du préfet dans laquelle l’assainissement non collectif (ANC) a un impact sanitaire sur un usage sensible,
- Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) / Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE),
- Présence de puits déclarés et utilisés pour l’alimentation en eau potable (contraintes sanitaires).
En résumé, l’aire de compostage ne doit pas être étanche sauf en zone à enjeu sanitaire ou environnemental, mais le SPANC doit vérifier que le système de compostage est adapté au milieu et ses spécificités, et au(x) foyers producteurs. Les points d’attention sont le ruissellement, la protection contre les intempéries, et le dimensionnement des équipements.
Et encore, dans ces zones, selon la proximité de la zone sensible, et les capacités du sol, certains acteurs préconisent une étanchéité latérale et sur une vingtaine de centimètres de profondeur, mais pas d’étanchéité complète.
Des bonnes pratiques sont référencées dans ces ressources :
- Guide du Réseau d’Assainissement Écologique
- Préconisations pour toilettes sèches domestiques de l’ADEME
Électricité
Lors de la construction, rénovation ou extension de tout bâtiment d’habitation, les propriétaires doivent respecter la norme électrique NFC 15-100, comme précisé dans l’arrêté du 3 août 2016 portant sur la réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation.
C’est le CONSUEL (Comité National pour la Sécurité des Usagers de l’Électricité) qui délivre l’attestation du même nom, notamment nécessaire pour toute habitation cédée ou louée, et pour le raccord au réseau public, que ce soit pour la consommation ou la production.
Au sens strict, un bâtiment est défini comme construction à usage d’habitation , ce qui exclut les installations comme les résidences démontables.
Cependant, certaines assurances habitation demandent de fournir cette attestation. Aussi, en cas d’envoi d’électricité sur le réseau, le CONSUEL est nécessaire. En cas de souscription d’un abonnement spécifiquement pour un habitat, il peut être difficile d’obtenir l’autorisation du gestionnaire de réseau.
L’approvisionnement en électricité est un critère de décence, ce qui est important en cas de location, d’accès aux prestations sociales etc. Mais le raccordement au réseau d’électricité est un droit (sauf en cas d’impossibilité technique) et non un devoir.
Compost des déchets domestiques
On distingue deux méthodes de compostage dans le cadre d’un hameau léger :
- les composts particuliers, lorsque chaque habitat dispose de son propre compost ;
- le compost de proximité, lorsque le hameau dispose d’un compost collectif.
La réglementation est très peu détaillée pour les composts alimentaires de particuliers. En effet, aucune démarche spécifique n’est nécessaire en dessous d’un volume de 5m³. Si un compost dépasse ce volume, il est recommandé de respecter une distance de 200m minimum par rapport aux premières habitations.
Cependant, il est bon de veiller à éviter les nuisances, en installant notamment son compost à distance des habitations du projet et du voisinage, et en respectant les bonnes pratiques liées au compostage.
L’arrêté du 9 avril 2018 présente, dans les articles 17 à 21 (source legifrance), le statut juridique du compostage de proximité. Ce dernier doit être réalisé sur place et pour un usage local, et ne doit pas dépasser 1 tonne de déchets produits par semaine. Si les quantités produites hebdomadairement dépassent cette valeur, se référer à l’article 21 pour une éventuelle dérogation.
Une personne physique ou morale alors être alors désignée comme responsable de la bonne gestion du compost (manipulation, prévention des risques de contamination, bonne montée en température, etc.).
Concernant les déchets non compostés, il faudra prévoir un stockage dans des conditions d’hygiène satisfaisantes et dans un lieu accessible aux services de collecte. Il faudra aussi s’assurer de leur possibilité de collecte par la collectivité compétente, à savoir la Mairie ou l’EPCI ayant cette compétence.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16217
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006143752/
Sécurité
Risque incendie
La compétence incendie est portée par la commune, qui doit s’assurer du respect des règles concernant la distance à la borne incendie, souvent 400m, et des accès des véhicules d’intervention (largeur, portance, rayon de braquage des voies d’accès). Dans certains cas, il est possible d’utiliser une réserve incendie sous forme de poches ou retenues d’eau.
Les règles spécifiques dépendent du SDIS local (pompiers) et sont soumises à l’appréciation du responsable prévention, qui peut, au cas par cas, faire des exceptions. Les sujets restent similaires :
- Distance entre les bâtiments, installations et la borne.
- Distance entre les bâtiments, installations et le camion d'intervention (utilisation de dévidoirs possibles).
- Portance, largeur, longueur des voies d'accès.
- Aire de retournement.
- Statut des bâtiments et installations, notamment ERP, cf. plus bas.
- Débit de la borne.
Les caractéristiques techniques du bâtiment n’impliquent pas nécessairement les mêmes exigences que son usage. Un bâtiment commun de plein pied et non mitoyen peut par exemple être considéré comme habitat individuel ne nécessitant pas de solliciter le SDIS, mais être classifié ERP (Établissement Recevant du Public), ce qui impose des normes supplémentaires mentionnées plus bas.
Stationnement et circulations
Ce sujet aussi dépend du contexte local, mais il conviendra de préciser comment s’effectue la circulation vers et depuis le projet, ses voies d’accès et zones de stationnement.
Il faudra prêter attention à la sécurité des manœuvres et notamment de la visibilité nécessaire à leur réalisation (marche avant, vue dégagée, etc.).
Aussi, il convient de s’assurer des obligations en termes de nombre de place de stationnement, précisées dans les documents d’urbanisme.
ERP (Établissement Recevant du Public)
Le bâtiment commun peut, selon son usage, sa destination au sens de l’urbanisme, et la position des services techniques instruisant la demande, être soumis aux normes ERP, déclinés en termes d’accessibilité et de prévention du risque incendie. Ces normes peuvent être fortement impactantes en termes de budget et de programme architectural.
Il faut se rapprocher de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) pour l’accessibilité et du SDIS (pompiers) pour le sujet incendie, et détailler l’usage du bâtiment, car il conditionne l’assujettissement. Si nécessaire, il faut justifier sa position dans le dossier d’instruction. Aussi, il peut être bon de contacter le bureau de contrôle de légalité de la préfecture, qui se prononce en fin d’instruction.

Les taxes
Taxe d’aménagement
Classiquement, la taxe d’aménagement est calculée en fonction du nombre de m2 desurface habitable et du nombre de places de parking. Vous pouvez faire des simulations en ligne.
Or, dans le cas du permis d'aménager, il y a un flou juridique car on ne déclare pas le nombre de m2. Il est donc impossible de calculer et donc de payer une taxe sur la base de la surface habitable.
En attendant que ce flou juridique soit comblé par les services de l’État avec lesquels nous avons pu échanger, vous pouvez :
- déclarer un nombre moyen de m2,
- être taxé comme un habitat léger de loisir ou un emplacement de camping. Consulter la loi ici.
Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB)
Vous paierez cette taxe s’il s'agit d’une installation via un bail emphytéotique ou un achat du terrain par le collectif d’habitant·es.
Vous ne paierez pas cette taxe s’il s'agit d'une simple location.
Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)
Le paiement de cette taxe dépend du type de construction. La propriété bâtie doit remplir les deux conditions suivantes :
- Être fixée au sol (avec impossibilité de la déplacer sans la démolir),
- Présenter le caractère de véritable bâtiment, y compris les aménagements faisant corps avec elle.
Les baraquements mobiles et les caravanes sont exonérés, sauf s'ils sont fixés par des attaches en maçonnerie.
La TFPB est donc due pour les espaces communs et les habitations n'étant ni mobiles ni facilement démontables.
Taxe d'habitation
Elle disparaît pour les résidences principales donc s'appliquent également pour ces résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Taxes sur les ordures ménagères
Plusieurs types de taxes permettent de faire fonctionner la collecte et le tri de vos déchets :
- La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) : une taxe de collecte et de tri de déchets obligatoire, même si vous passez seulement un court séjour dans la propriété concernée. Elle sera, dans ce cas, due si la construction est soumise à la TFPB.
- La redevance d'enlèvement d'ordures ménagères (REOM) : cette taxe est soumise au service d’enlèvement d'ordures ménagères (seulement si vous utilisez ce service). C'est la commune qui décide a priori et qui s'occupe de récolter les paiements, donc a priori tous les habitant·es qui utilisent le service d'enlèvement des ordures ménagères sont concerné·es.
- La redevance spéciale : **seulement pour les services d’élimination de déchets assimilés aux déchets ménagers. Elle est due uniquement en cas d’utilisation de ce service, évaluée en fonction de l’importance de la prestation rendue, notamment calculée par rapport à la quantité de déchets gérée.
D'autres impôts locaux sont à considérer comme la taxe de raccordement au réseau d'assainissement (PFAC) s'il s'agit d'un branchement au réseau d'assainissement collectif.
Les taxes
Taxe d’aménagement
Classiquement, la taxe d’aménagement est calculée en fonction du nombre de m2 desurface habitable et du nombre de places de parking. Vous pouvez faire des simulations en ligne.
Or, dans le cas du permis d'aménager, il y a un flou juridique car on ne déclare pas le nombre de m2. Il est donc impossible de calculer et donc de payer une taxe sur la base de la surface habitable.
En attendant que ce flou juridique soit comblé par les services de l’État avec lesquels nous avons pu échanger, vous pouvez :
- déclarer un nombre moyen de m2,
- être taxé comme un habitat léger de loisir ou un emplacement de camping. Consulter la loi ici.
Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB)
Vous paierez cette taxe s’il s'agit d’une installation via un bail emphytéotique ou un achat du terrain par le collectif d’habitant·es.
Vous ne paierez pas cette taxe s’il s'agit d'une simple location.
Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)
Le paiement de cette taxe dépend du type de construction. La propriété bâtie doit remplir les deux conditions suivantes :
- Être fixée au sol (avec impossibilité de la déplacer sans la démolir),
- Présenter le caractère de véritable bâtiment, y compris les aménagements faisant corps avec elle.
Les baraquements mobiles et les caravanes sont exonérés, sauf s'ils sont fixés par des attaches en maçonnerie.
La TFPB est donc due pour les espaces communs et les habitations n'étant ni mobiles ni facilement démontables.
Taxe d'habitation
Elle disparaît pour les résidences principales donc s'appliquent également pour ces résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Taxes sur les ordures ménagères
Plusieurs types de taxes permettent de faire fonctionner la collecte et le tri de vos déchets :
- La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) : une taxe de collecte et de tri de déchets obligatoire, même si vous passez seulement un court séjour dans la propriété concernée. Elle sera, dans ce cas, due si la construction est soumise à la TFPB.
- La redevance d'enlèvement d'ordures ménagères (REOM) : cette taxe est soumise au service d’enlèvement d'ordures ménagères (seulement si vous utilisez ce service). C'est la commune qui décide a priori et qui s'occupe de récolter les paiements, donc a priori tous les habitant·es qui utilisent le service d'enlèvement des ordures ménagères sont concerné·es.
- La redevance spéciale : **seulement pour les services d’élimination de déchets assimilés aux déchets ménagers. Elle est due uniquement en cas d’utilisation de ce service, évaluée en fonction de l’importance de la prestation rendue, notamment calculée par rapport à la quantité de déchets gérée.
D'autres impôts locaux sont à considérer comme la taxe de raccordement au réseau d'assainissement (PFAC) s'il s'agit d'un branchement au réseau d'assainissement collectif.

Loi ZAN - artificialisation - comptabilisation
La loi climat et résilience du 22 août 2021 a fixé l’objectif d’atteindre le « zéro artificialisation nette des sols » (ZAN) en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d’ENAF dans les dix prochaines années (2021-2031). Cette trajectoire progressive doit être déclinée territorialement dans les documents de planification et d’urbanisme (source Ministère de la Transition écologique). « L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage » (source Ministère).
Cette loi est une petite révolution qui bouleverse les manières d’aménager avec de multiples conséquences sur toute la chaîne de production de logements. Elle vise à répondre à des enjeux majeurs de préservation de la biodiversité et des terres, défendus par notre association Hameaux Légers. C’est à la fois une menace et une opportunité pour les projets d’habitat réversible et de hameaux légers, qui nécessite d’adapter les discours et les modes opératoires.
Le Ministère a néanmoins partagé une nouvelle nomenclature dans un décret du 27 novembre 2023 : une surface de moins de 50m2 dont le sol est imperméabilisé en raison du bâti (constructions, aménagements, ouvrages ou installations) n’est alors pas sensée être considérée comme artificialisée.
Loi ZAN - artificialisation - comptabilisation
La loi climat et résilience du 22 août 2021 a fixé l’objectif d’atteindre le « zéro artificialisation nette des sols » (ZAN) en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d’ENAF dans les dix prochaines années (2021-2031). Cette trajectoire progressive doit être déclinée territorialement dans les documents de planification et d’urbanisme (source Ministère de la Transition écologique). « L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage » (source Ministère).
Cette loi est une petite révolution qui bouleverse les manières d’aménager avec de multiples conséquences sur toute la chaîne de production de logements. Elle vise à répondre à des enjeux majeurs de préservation de la biodiversité et des terres, défendus par notre association Hameaux Légers. C’est à la fois une menace et une opportunité pour les projets d’habitat réversible et de hameaux légers, qui nécessite d’adapter les discours et les modes opératoires.
Le Ministère a néanmoins partagé une nouvelle nomenclature dans un décret du 27 novembre 2023 : une surface de moins de 50m2 dont le sol est imperméabilisé en raison du bâti (constructions, aménagements, ouvrages ou installations) n’est alors pas sensée être considérée comme artificialisée.

Quelques ressources complémentaires
- Notre Webinaire : S'installer légalement en habitat réversible
- Notre MOOC S’installer en habitat réversible (cours en ligne gratuit et accessible à toutes et tous) qui offre un maximum d’informations, et en particulier la séquence 3 "Réglementation".
- Notre Livre Habiter Léger
- Notre Dossier d’exemple de PLU(i) intégrant l’habitat réversible : tous les PLU (ou PLUi) prenant en compte les habitats démontables à notre connaissance, que ce soit en créant des STECAL ou en leur dédiant des zones constructibles. Vous trouverez dans ce dossier des exemples de rédaction d'OAP et de règlements intégrant l'habitat réversible.
- Notre Dossier d’exemples de permis d’aménager : des exemples de permis d'aménager acceptés par l'administration pour installer des résidences démontables.
- NotreDossier d’exemples de démarches pour s’installer sur un terrain non constructible hors STECAL (permis précaire, autorisation destationner, ...)
Quelques ressources complémentaires
- Notre Webinaire : S'installer légalement en habitat réversible
- Notre MOOC S’installer en habitat réversible (cours en ligne gratuit et accessible à toutes et tous) qui offre un maximum d’informations, et en particulier la séquence 3 "Réglementation".
- Notre Livre Habiter Léger
- Notre Dossier d’exemple de PLU(i) intégrant l’habitat réversible : tous les PLU (ou PLUi) prenant en compte les habitats démontables à notre connaissance, que ce soit en créant des STECAL ou en leur dédiant des zones constructibles. Vous trouverez dans ce dossier des exemples de rédaction d'OAP et de règlements intégrant l'habitat réversible.
- Notre Dossier d’exemples de permis d’aménager : des exemples de permis d'aménager acceptés par l'administration pour installer des résidences démontables.
- NotreDossier d’exemples de démarches pour s’installer sur un terrain non constructible hors STECAL (permis précaire, autorisation destationner, ...)
BOîte à OUTILS
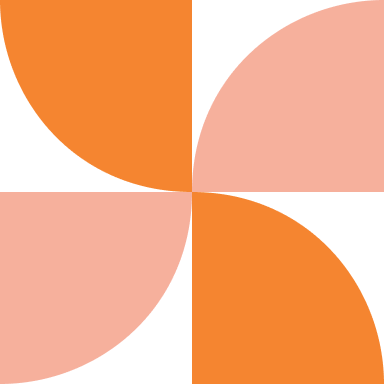
Ateliers

Apports théoriques

Documents exemples et témoignages
ET APrès

Droit d'usage de cette ressource
Cette ressource créée par Hameaux Légers est sous licence CC-BY-SA 4.0. Vous pouvez donc l’exploiter (partager, copier, reproduire, distribuer, communiquer, réutiliser, adapter) par tous moyens et sous tous formats pour des fins commerciales ou non.
Les seules obligations sont de :
- créditer l’association Hameaux Légers comme auteur de l’œuvre originale, d’indiquer la source et d’indiquer si vous avez effectué des modifications.
- diffuser votre contenu sous la même licence.
Vous avez une suggestion ou une ressource à nous partager ?